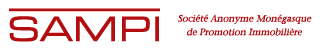A chaque numéro, Code Sport Monaco vous propose de découvrir les personnalités sportives de la Principauté sous un autre angle. Serge Savelli, responsable de boutique chez Zegg & Cerlati et ancien coureur cycliste de haut niveau, s’est prêté à l’exercice du « Qui es-tu ? ».
Vos premiers sports ?
J’ai commencé par le foot. Je ne jouais pas en club, simplement dans le quartier à Drap avec mon père et des copains. Il nous sortait pour qu’on se défoule. Ce n’est que bien plus tard que j’ai découvert le cyclisme, ma véritable passion.
Pourquoi le cyclisme ?
Mon père roulait un peu, il m’a mis le pied à l’étrier quand j’avais 12 ans. Par la suite, j’ai rejoint une équipe et j’ai pris goût à l’effort. A la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), il y avait une petite vedette qui gagnait absolument tout et l’idée de le concurrencer me plaisait bien. J’avais cette volonté de me confronter aux meilleurs.
Votre parcours ?
Comme je marchais bien, les dirigeants de la FSGT m’ont conseillé de partir à la Fédération française pour goûter au haut niveau. Je me suis retrouvé à l’ES Cannes avec les frères Virenque. On formait une très belle équipe, dure à battre. On sillonnait la France, parfois avec des professionnels. Ça roulait vraiment bien. Puis j’ai dû faire mon service militaire.
La fin de vos ambitions ?
Dante Lavaca, un homme très respecté dans le milieu cycliste, m’a fait rentrer en équipe de France militaire. J’étais à l’armée de l’air avec Gilles Delion (Tour de Lombardie 1990, une étape du Tour de France 1992…). Par la suite, j’ai signé dans la plus grosse équipe en France, l’Athletic Club Boulogne-Billancourt (ACBB), puis dans une autre équipe en Savoie. En 1989, j’ai tenu tête à Niki Ruttiman, qui venait de finir huitième du Tour de France, sur la course Annemasse-Bellegarde-Annemasse. Ce jour-là, il m’a manqué un petit truc.
Votre premier souvenir ?
Ma passion pour le cyclisme est née grâce à Bernard Hinault. C’était le meilleur à l’époque. Je me souviens d’un Critérium du Dauphiné où il chute dans une descente alors qu’il est en tête. On le voit alors sortir du ravin et remonter sur son vélo, sans broncher. Ça a provoqué un déclic chez moi. J’avais envie d’être aussi fort que lui.
Le meilleur ?
Le Tour du Vaucluse en 1991. Je roulais pour un club aixois et j’avais été sélectionné en équipe de Provence pour disputer cette course Open où figurait Miguel Indurain. L’Espagnol venait de remporter la deuxième étape, un contre-la-montre. J’avais 1’30 de retard sur lui. Le lendemain, alors qu’on venait de monter un col et que les Banesto roulaient en tête, l’orgueilleux que j’étais est parti en échappée. J’ai compté jusqu’à 2’30 sur Indurain. Le maillot jaune ne lui appartenait virtuellement plus.
Comment ça s’est terminé ?
Ses équipiers ont roulé pour lui et il a fini par me rattraper à 20 km de l’arrivée. (Rires.) Mais j’ai récemment appris par un copain de l’équipe de France que les Banesto avaient demandé du renfort à d’autres formations. Les journalistes m’avaient fait un bel article. (Il récite) « Ils n’ont pas voulu que le petit vienne jouer dans la cour des grands. Heureusement que Savelli était là pour animer la course. » Le lendemain, Indurain m’a serré la main. Deux mois plus tard, il remportait son premier Tour de France. Je dis toujours en rigolant que je l’ai fait progresser ! (Rires.)
Et votre pire souvenir ?
Un Paris-Roubaix sous la pluie avec Gilles Delion. 220 km cauchemardesques. J’étais passé en tête dans le premier secteur pavé, mais je me suis fait une entorse du genou. Je n’avais jamais vu de pavé de ma vie. On nous conseillait de ne pas trop serrer le guidon au risque d’avoir des crampes. Les coups, les chutes… Il fallait éviter les coureurs au sol. Qu’est-ce que c’était dur !
Votre profil de coureur ?
J’étais assez complet, mais je montais bien, je préférais les bosses au plat. J’étais assez léger pour grimper, et endurant pour tenir le rythme à haute intensité. Dans les bons jours, quand j’avais des sensations de folie, je ne craignais personne.
L’athlète qui vous a inspiré ?
Bernard Hinault. J’admirais sa détermination, son regard de tueur. Il avait la rage, « le Blaireau », il ne lâchait rien. C’était un modèle.
Le métier que vous rêveriez d’exercer ?
Directeur d’équipe m’aurait plu. Quand je serai à la retraite, je m’occuperai peut-être des jeunes. Ce qui me fait peur, c’est la dangerosité de ce sport. Je continue de rouler une à deux fois par semaine et la cohabitation avec les voitures est vraiment difficile. Il n’y a pas longtemps, un automobiliste m’a frôlé. Je me demande comment j’ai fait pour rester debout. A vélo, on est régulièrement confronté à l’agressivité des gens. A force, ça crée de l’appréhension.
Vos autres passions ?
Mon travail. J’ai toujours été attiré par le milieu de l’horlogerie. Avant de me laisser assouvir ma passion, mon père m’a demandé d’apprendre un métier. « On ne sait jamais », disait-il. Et il avait raison. Je lui dis encore merci car je n’ai pas flanché en arrêtant ma carrière. La retraite sportive est une petite mort. Elle est dure à encaisser quand on a 24 ans, mais j’avais un métier auquel me raccrocher. J’ai retrouvé cette adrénaline dans certaines occasions au travail.
L’anecdote que vous n’avez jamais révélée ?
Je venais de rejoindre l’ACBB et on disputait une belle course dans la région. On était deux en échappée. Un coureur d’une autre formation, alors en équipe de France, m’a proposé de l’argent pour que je le laisse gagner. Il avait une force de taureau, très impressionnante. Moi, j’étais redoutable sur le sprint. Il est revenu à la charge trois fois. Sûr de moi, j’ai refusé. Il a finalement eu le dernier mot à la loyale. Ce jour-là, j’ai tout perdu : la course et l’argent ! (Rires.)
Propos recueillis par Jérémie Bernigole